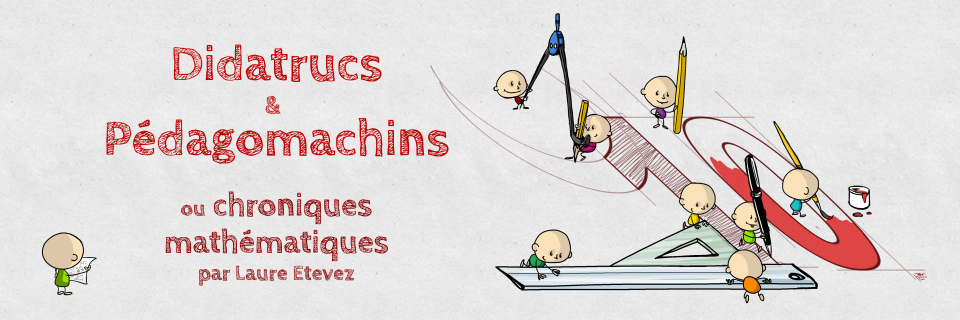Une nouvelle étude faisant état d’écarts de réussite en maths entre les filles et les garçons dès le CP vient de sortir. Si cette étude ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, il semble qu’elle concerne un échantillon d’élève particulièrement grand. Surtout, elle bénéficie d’une couverture médiatique importante, et de son lot d’interprétations problématiques.
Cela m’a donné envie de revenir sur quelques remarques que l’on entend souvent dans ce type de contexte. Il n’est d’ailleurs pas impossible que cet article s’étoffe d’autres remarques du même genre au fur et à mesure.
Cela prouve que ça se joue très tôt, alors inutile d’agir dans le secondaire/supérieur, c’est bien trop tard !
Effectivement, on commence à voir des effets très tôt. En déduire qu’il est inutile d’agir dans le secondaire ou le supérieur me semble être un cheminement de pensée à la logique approximative : ce n’est pas parce que le phénomène démarre dès la petite enfance qu’il n’y a rien à faire après !
Alors on pourrait effectivement se dire qu’il est plus efficace d’agir à la racine. Moui, théoriquement, dans un univers dénué de réalité ce serait peut-être vrai. Mais dans la vraie vie, cela reviendrait à :
- Renoncer à faire évoluer les choses pour les filles qui ont déjà plus de 10 ans.
- Accepter l’idée que les évolutions ne pourraient avoir des effets sur les trajectoires étudiantes que dans 15 ans, et encore, en partant du principe qu’on arriverait à tout résoudre en un claquement de doigt pour la petite enfance. J’ai comme un doute.
Et puis, qui interagi avec les enfants ? Les parents, la famille, les enseignant·es, les éducateurices… Ne serait-il pas nécessaire de changer les représentations de tou·tes ces adultes ? Les enfants grandissent dans une société marquée par un fonctionnement patriarcal qui génère un sexisme systémique. C’est donc bien à tous les niveaux en même temps qu’il convient d’agir.
C’est à l’école que ça se passe… c’est donc à l’école d’agir
Alors ce n’est pas parce que c’est en CP que l’on en voit les premiers effets que les stéréotypes n’ont pas commencé à agir avant. Et quand bien même, les élèves de CP ne vivent pas que à l’école. Il faut un plan de formation ambitieux pour les enseignants quelque soit leur niveau d’enseignement, c’est indéniable. Mais prétendre que l’école seule pourrait tout résoudre est illusoire : on est bien face à un phénomène systémique qui émane de la société toute entière. Les enseignants sont de bonne volonté, mais ils n’ont pas de pouvoir magique. Nous sommes tou·tes emprunts de stéréotypes et nous devons tou·tes contribuer à lutter contre le sexisme.
On ne va quand même pas obliger les filles à faire des sciences si elles n’en ont pas envie !
Non, effectivement. Personne n’a jamais voulu faire cela. D’ailleurs, cette remarque ramène le sujet sur un plan individuel alors qu’en fait l’enjeu est global. Si votre petite cousine a envie d’étudier la coiffure plutôt que la physique, qu’elle le fasse, c’est super d’avoir une passion dans la vie et d’aimer ce qu’on fait. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un sujet lorsque l’on constate que tout un groupe social s’oriente dans une direction plutôt qu’une autre.
En fait, cela invite à s’interroger sur ce qui fait que les filles développent un goût pour certaines disciplines et pas pour d’autres. Il se trouve que le goût se construit. C’est (au moins en partie) un produit de l’éducation et de la socialisation. On peut donc a minima ne pas voir comme une fatalité le fait que les filles n’aient pas envie d’aller faire des mathématiques ou des sciences, mais chercher ce qui contribue à ne pas leur faire aimer ces disciplines et envisager des leviers d’action pour ouvrir leurs horizons.
Et quand est-ce qu’on s’occupe des garçons qui ne s’orientent pas en lettres ? On ne se préoccupe que des filles !
Le fait que les garçons ne s’orientent pas dans les métiers du soin me semble relever du même phénomène que celui que l’on dénonce pour les filles (et être plus ennuyeux que le fait qu’ils ne s’orientent pas dans des filières littéraires parce que les conséquences sur la société sont bien plus importantes). Toutefois, les enjeux ne sont absolument pas les mêmes.
Il se trouve que nous vivons dans une société dans laquelle on accède aux postes les plus rémunérateurs et les plus socialement reconnus via des filières scientifiques (pas seulement, mais quand même beaucoup, et en tout cas, plus que via les filières du care). Donc, le fait que les filles ne s’orientent pas vers ces filières a de lourdes conséquences sur leurs trajectoires de vie : en termes de carrière et de sécurité financière évidemment, mais pas seulement. Ne pas avoir de femmes à des postes de pouvoirs induit des choix biaisés lors de prises de décisions. A titre d’exemple, on peut citer les orientations de recherche dans l’industrie pharmaceutique ou les crash-test de voiture.
En fait, ce sont les filières les plus valorisées socialement qui sont investies par les garçons. L’évolution des proportions de filles et de garçons dans les filières informatiques depuis les années 60 est très bien documentée et montre bien à quel point une question de hiérarchie sociale se cache derrière la question des choix d’orientation. D’ailleurs, même au sein des sciences, on observe des écarts importants suivant les sciences, traduisant une hiérarchie entre des sciences qui seraient plus nobles que d’autres : les garçons vont plutôt aller en mathématiques ou en physique alors que les filles vont préférer la chimie ou la biologie.
Alors oui, il y a un effet sur les garçons mais :
- Il n’a pas du tout les mêmes conséquences sur leurs trajectoires de vie.
- Il participe du même phénomène : si on payait les infirmières autant que les ingénieurs, on aurait sans aucun doute plus d’infirmiers.
Celleux auxquel·les on ne pense pas assez, ce sont les enfants de milieux défavorisés, filles ou garçons, qui subissent des phénomènes de discrimination comparables mais qui sont moins visibles et moins médiatisés.
Cette mesure n’est pas la bonne, il faudrait plutôt…
Merci Jean-Michel pour ton expertise. Mais je te ferais remarquer que nous n’avons pas le temps de disserter pendant des mois voire des années pour trouver LA mesure qui serait la meilleure. D’ailleurs, spoiler alert, elle n’existe pas. L’enjeu est trop grave, trop important, et trop complexe, pour que l’on se permette le luxe de renoncer à un levier, quand bien même il ne te semblerait pas idéal.
Alors, exemple au hasard, peut-être qu’effectivement, les politiques de quotas ne représentent pas un idéal désirable. Mais c’est un moyen de limiter l’effet « boy’s club » et donc les violence sexistes et sexuelles qui concourent grandement au fait que les filles ne s’orientent pas en sciences (et qui, accessoirement, sont source de souffrance).
Donc plutôt que de critiquer une mesure qui ne te semble pas aussi géniale que ton idée, je te propose que tu laisses faire pour celle-là et que tu utilises plutôt ton énergie à militer pour que d’autres mesures qui te semblent plus pertinentes soient mises en place également.
Et puisqu’on discute, Jean-Michel, je te signale que tu es un homme et que donc il serait préférable que tu ne contredises pas les femmes qui s’expriment sur le sujet et que tu choisisses plutôt de te taire et de les écouter. Ce sera déjà un grand pas, merci bien.